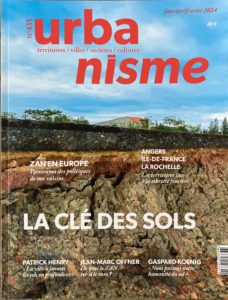Le rédacteur en chef de la Revue URBANISME, pour le N°435, m’a demandé d’écrire un article pour témoigner de l’émergence de la construction terre en Région Paca.
Le Sud-Est redécouvre la terre crue !?
(article version longue)
C’était l’objectif des rencontres Régionales de la construction terre en PACA, à Salernes (Var), 22/23 septembre 2023.
Mais pourquoi choisir Salernes, connu pour ses céramiques !? Car ils utilisent l’argile pure et leurs rebus sont parfaitement adaptés à la construction terre.
Le Musée de la céramique Terra Rossa a, du coup, le projet d’intégrer prochainement cette dimension. La Mairie de Salernes a saisi l’opportunité de ces Rencontres.
La Région PACA est très en retard par rapport à d’autres Régions. Et pourtant, la terre argileuse est bien présente. Le mortier et les enduits de bien des maisons en pierre sont à base d’argile. L’atelier MARE a présenté l’utilisation du pisé à Carpentras ou à La Crau en Camargue.
C’est un des autres objectifs des organisateurs : recenser les bâtiments utilisant la terre, anciens et contemporains, pour les cartographier avec différents acteurs associatifs, CAUE, ENSAM,…
Les associations Envirobat-BDM, EcoBatissonS, Banco’ ont mobilisé les différents acteurs de la Région PACA pour ces 2 jours, avec comme objectif le changement de pratiques constructives afin de réduire l’impact global de l’acte de construire. En particulier du béton. Mais la mise en place d’une filière est complexe. Chaque maillon de la chaîne de valeur doit être mobilisé et être prêt au bon moment : extracteurs – transformateurs – concepteurs – prescripteurs – applicateurs – formateurs – distributeurs – maitres d’oeuvres et d’ouvrages, …
L’offre doit créer la demande !? … peut-être mais en sensibilisant la demande suffisamment en amont, pour sécuriser l’implantation de nouveaux producteurs locaux. A l’inverse, si le constructeur ne trouve pas la matière prescrite, disponible aisément, il va proposer autre chose, si l’on ne peut utiliser pas la terre du site.
Les institutions, les médias et les prescripteurs, doivent se saisir du sujet.
Inquiétude pour la terre !
La situation est devenue préoccupante. A d’autres époques, les aménageurs n‘hésitaient pas à combler des vallées, pour « évacuer » les terres d’excavations, en créant de nouvelles surfaces à bâtir. Heureusement ces pratiques ont quasiment disparues. Reste les montagnes de terres qui poussent (env. (?)190 000 tonnes/an en PACA), sur les plateformes de stockage, à chaque nouveau chantier ou mine. Ou encore en déballes sauvages, par des pratiques mafieuses.
Que faire de ces buttes géantes ?
Réponses à la 1° table ronde : Mobilisation du gisement avec A. Blanc (Ecominéro), E. Laville (Groupe Poisson, Terre durable), D. Luneau (Manufacture des terres méditerranéennes, G. Tartayre (Terres & Fibres d’Azur).
Pour une économie circulaire
Mais la terre crue ne doit pas être perçue seulement dans une visée de gestion de stock de déchets à valoriser. C’est déjà une vraie solution de l’économie circulaire de l’extraction au projet final, et même avec son recyclage.
Il est donc important d’inclure dans la filière, les entreprises de terrassements qui, avec les plateformes, ont la connaissance des futurs sites d’extraction qui peuvent être mobilisés pour un chantier voisin. Limitant, de fait, l’incidence transport : le seul gros poste de GES* de la terre crue.
L’utilisation de la terre du site, ou d’un site voisin, si la terre du chantier ne convient pas, est donc à privilégier. De ce fait, la terre ne passera pas par la classe réglementaire du déchet.
Un major du BTP prépare des solutions de Big-Bag ou containers de « bétons de terre » prêts à l’emploi. Mais entre la fabrication des adjuvants, souvent à base de ciments (laitiers,…) et le transport, impliquant une chaine logistique +ou- longue, cela peut réduire l’intérêt de la terre.
L’intervenant chercheur, Erwan Harmand** montre que l’ACV* entre la mise en oeuvre de la terre crue « non adjuventé » : de 0,5 kg à 16 kg CO2 eq par m2 de mur en terre crue, par rapport à un béton de terre adjuvanté (stabilisé au ciment, chaux), entre 45 et 240 kg CO2 eq par m2 de mur en terre crue** (Rappel : 250 à 350 kgCO2eq/m² IFPEB).
En fin de vie, une terre crue « pure », pourra être réemployée pour construire ou même être répartie dans un champ, ce qui sera difficilement le cas en présence de liants.
Il prévient, l’ajout d’adjuvants peut, dans certains cas, dégrader la tenue de la terre. D’où, l’importance de l’analyse en labo (Filiater.fr), de la composition de la terre.
Il devrait y avoir une prise en compte par les bureaux de contrôle et les assureurs pour éviter ces liants, partout où cela n’est pas impératif. Ce qui est, pour l’instant, difficilement accepté, surtout en zones sismiques.
Les techniques devraient évoluer avec la R&D en cours.
Une table ronde : Assurabilité des bâtiments en terre avec L. Dandres (Apave), H. Catrevaux (SOCABAT), S. Martin (SMABTP), C. Aubry (EcoBatissons). Lever tous les freins risque de prendre encore du temps !
Le tremblement de terre du Maroc de septembre 2023, a marqué les esprits.
Mais les solutions existent. D’ailleurs, la collaboration avec les instances marocaines, pour bénéficier des retours d’expériences, nous serait précieuse. D’autant qu’ils ont déjà des règles parasismiques de la construction en terre. On peut espérer qu’elles seront respectées pour la reconstruction.
Salima Naji***, qui a accepté d’être la marraine de la démarche d’EcoBatissonS pour la terre crue, défend avec la plus grande vigueur, la reconstruction en terre, pour ses performances thermiques, la réparabilité à moindre coût dans ces vallées reculées, de ces architectures de « collectes » (pierre/terre/bois).
Mais pourquoi construire en terre crue ?
C’est ce que j’appellerai le moteur thermique du bâtiment bioclimatique.
En hiver, les murs d’inertie, en terre, se chargent de calories, par conduction, dans la journée. Elles sont restituées la nuit, par le rayonnement des infra-rouges longs, grâce au déphasage.
A l’inverse, l’été, la sur-ventilation nocturne permet aux frigories de se stocker dans ces mêmes murs. Dans la journée, les locaux bioclimatiques, protégés du rayonnement solaire, bénéficie de la fraicheur restituée.
Deuxième avantage : Le lissage hygrométrique. La terre crue absorbe le trop plein d’humidité de l’air et la restitue si l’air est trop sec.
Le sentiment de confort thermique et hygrométrique est bien ressenti.
L’utilisation de la terre crue se conçoit en synergie avec l’utilisation des fibres végétales. Aussi bien en isolation, par l’extérieur, et en composant structurant, dans un mélange terre-fibres.
Mais aussi pour sa beauté intrinsèque. Les diaporamas en ont témoigné.
Le centre aéré de Ramatuelle (Guy Martin – Ramatuelle, Y. Doligez)
La maison de santé de Charleval 2023 (M. Mingucci – Filiater) en gros blocs de 40x50x80 cm (85% des déblais utilisés).
Les projets de l’île des Embiez, (ANatomies d’Architecture)
Divers projets de Trihab (B. Bazire)
Le traditionnel béton de chaux/chanvre se décline maintenant avec de l’argile, pour diminuer son bilan carbone, avec DB chanvre (83) et Écobati à Briançon (05).
Les associations ANA (ANatomies d’Architecture) et DeBoue, ont organisés des ateliers pratiques. Rien de plus important de mettre les mains dans la terre pour sentir sa douceur et le plaisir de travailler ce matériau multi-millénaire.
Et maintenant ?
Avec un panel de bâtiments existants référencés qui faciliterait l‘acceptation de la terre comme matériau de construction courant. Par la formation d’artisans, des entrepreneurs motivés et leurs retours d’expériences des chantiers, des assureurs et des bureaux de contrôles audacieux et une floraisons de R&D, la terre crue à de beaux jours devant elle. Il reste à créer une association régionale spécifique pour accompagner son développement.
GES : Gaz à Effet de Serre
L’ACV : Analyse de Cycle de Vie = Bilan carbone et ressources utilisées.
** E. Hamard https://projet-national-terre.univ-gustave-eiffel.fr/.
*** Salima Naji : Architecte Franco-Marocaine et anthropologue
Retrouvez les audios et diapos des présentations :
https://www.enviroboite.net/1eres-rencontres-regionales-de-la-construction-terre-en-region-provence-alpes-cote-d-azur